Entre mobilités choisies, allers-retours fertiles et identités plurielles, la rubrique “Diaspora” de Let’s Go s’ouvre sur une réflexion personnelle et engagée. Pour ce premier numéro, Baptiste Heintz, co-fondateur du réseau cosmopolitain et observateur actif des dynamiques diasporiques, nous invite à changer de regard sur ses parcours de vie et de lien.
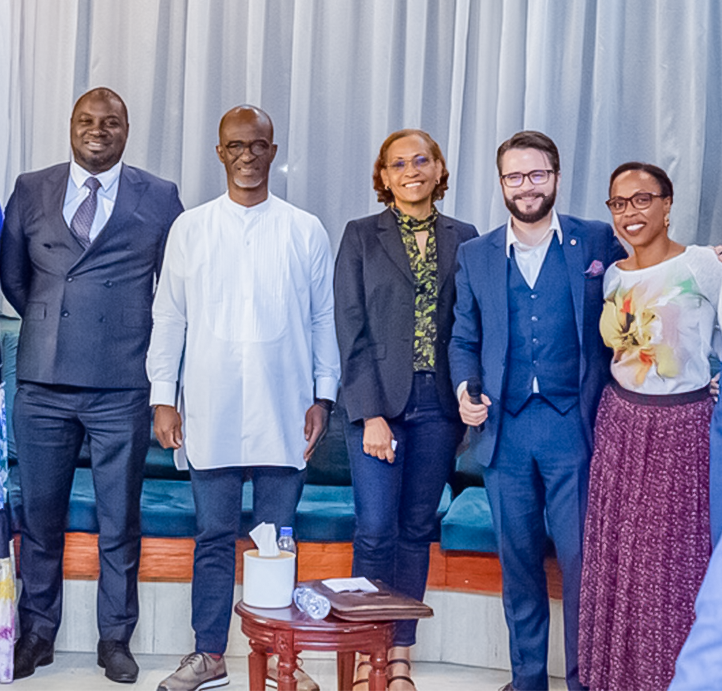
À chaque époque ses mots. Des mots pour nommer des réalités : parfois immuables, parfois nouvelles, parfois simplement renouvelées. Aujourd’hui, on parle de mobilité internationale. C’est plus joli, plus humain que « immigration légale » ou pire, « immigration choisie ».
Le premier est administratif, froid : un déplacement autorisé. On ne sait pas trop si on est le bienvenu, mais on a le droit d’être là. C’est déjà ça.
Le second est plus politique… Être « choisi », cela sonne bien, tant qu’on ne pense qu’à soi. Mais quand on comprend qu’être choisi, c’est être sélectionné selon les besoins (pressants) de l’invitant… alors sa supposée bienveillance se révèle souvent comme un simple intérêt.
Alors on préfère « mobilité internationale ». Être mobile, c’est bouger, peut-être choisir. On se sent plus libre. Et lorsque cela devient « international », on franchit les frontières, on traverse les mondes.
Cette mobilité est une constante humaine. On construit certes des murs et des frontières, mais surtout des portes, des routes, des ponts. Une partie de nous a toujours fait de sa vie un voyage.
Les marchands marchaient, les marins voguaient, les caravanes traversaient, les nomades passaient, les pèlerins visitaient… Les colons s’installaient, les réfugiés cherchaient un abri.
Les travailleurs itinérants vendaient leur savoir-faire de ville en ville ; les paysans quittaient une terre asséchée pour une terre promise ; la jeunesse cherchait de l’air pour mieux respirer.
Alors comment appelle-t-on les gens qui bougent ?
Longtemps, on a dit expatriés : des contractuels envoyés en mission par leur État ou leur entreprise. Mais ça, c’est au XXe siècle.
Maintenant, on parle de repat’, pour dire « repatriés ». Un néologisme créé en opposition aux expatriés, mais à ne surtout pas confondre avec les rapatriés.
Les rapatriés sont ceux qu’on ramène au pays, souvent dans des conditions loin d’être reluisantes. Les repat’, eux, sont ceux qui, après un long moment ailleurs, reviennent d’eux-mêmes. Fils ou filles prodigues ? Parfois. En tout cas, ils incarnent une réalité nouvelle de nos sociétés, et particulièrement à Abidjan, si rayonnante et attractive. On peut donc être un repat’, et au pluriel, les repat’ font toujours partie de cette communauté internationalisée.
C’est alors qu’on célèbre le retour du mot “diaspora”.
Un mot né dans la douleur, celle de la dispersion du peuple juif par Rome. Dispersés, mais gardant vive la mémoire de leur origine et de la cause de leur déracinement. Une tragédie, mais aussi une impressionnante source de résilience. Depuis, d’autres peuples se sont approprié ce mot. D’abord dans le contexte des anciens empires coloniaux. Puis, ces communautés sont devenues des forces vives pour leurs pays d’origine. Finalement aujourd’hui, on les reconnaît comme des richesses et des opportunités pour les pays qui les accueillent… même si certains restent à convaincre.
C’est l’un des chantiers que nous avons ouvert avec des camarades, en créant d’abord le club PariBabi à Abidjan, puis le Réseau Cosmopolitain, à destination du grand monde francophone. Et désormais, à travers cette rubrique du magazine Let’s Go.
Let’s Go pour les prochains numéros. Nous explorerons ensemble cette réalité en perpétuelle évolution, ses projets, ses voix, ses élans. Parce que la diaspora, c’est plus qu’un lien : c’est une richesse vivante d’une société qui avance.
Par Baptiste Heintz